

Ce travail a été présenté dans le cadre du séminaire SMAS organisé par l'INRA-SAD
Figure 1: structure des deux modèles indépendants
Figure 2: de la perception à la formalisation de la relation ressource - exploitation.
Figure 3: structure du modèle couplé.
Figure 4: Organigramme du processus de couplage entre pêcheurs et poissons
Figure 5: Dynamique d'une configuration viable
Figure 6: "transparence" de l'écosystème: effets sur la dynamique de la ressource
Figure 7: opportunisme des pêcheurs: effets sur la dynamique de la ressource
La recherche menée dans le cadre du projet MOPA (Modélisation de la Pêche Artisanale) s'insère dans le cadre de la réflexion sur la viabilité des systèmes écologiques et économiques. La modélisation présentée dans ce travail se réfère à la compréhension des conditions de développement durable d'une exploitation halieutique. Compris comme une interaction entre Nature et société, nous nous sommes intéressés aux modalités du couplage au moyen de modèles multi-agents.
Le modèle est fondé sur la représentation du comportement des communautés
actives (pêcheurs et mareyeurs) en interaction avec la variabilité de la ressource naturelle et du
contexte socio-économique dans lequel ils s'insèrent. L'environnement est naturel d'un côté,
économique de l'autre. Dans ce cadre, les changements exogènes se réfèrent à
l'aspect biologique de l'exploitation (effets des conditions écologiques sur la ressource (e.g., global
change, fluctuations de l'upwelling) ou à l'économie de l'exploitation (changement du cours des espèces,
valeur de la monnaie).
On cherche donc à représenter une exploitation en tant que système dans un environnement,
système soumis et répondant à des changements soit exogènes soit endogènes.![]()
L'approche retenue pour rendre compte du comportement de l'exploitation repose sur l'utilisation
conjointe d'une approche systémique et d'un formalisme multi-agent (Ferber, 1995 ). Deux modèles multi-agents ont été
développés. Le premier (Le Fur,
1998) traite de la dynamique d'une exploitation (les pêcheurs et les mareyeurs
artisans au Sénégal), l'autre (Le Fur et Simon, en prep.) de la dynamique d'une ressource
marine (le stock de sardinelles, Sardinella aurita, poisson pélagique des côtes d'Afrique de l'Ouest).Ce
formalisme est utilisé pour représenter des communautés de pêcheurs, mareyeurs, consommateurs,
les environnements dans lesquels ils évoluent (ports, marchés, zones de pêche) et les connaissances
(biologiques, économiques, techniques) dont ils disposent. Cette échelle locale caractérise
un niveau où la dynamique se crée (décisions, actions, communication). Par sommation de ces
micro-dynamiques en interaction, on peut se replacer à un niveau global et observer le comportement d'ensemble
de l'exploitation simulée.![]()
Chaque modèle a fait l'objet d'un développement séparé, dynamique de ressource sans pêche, dynamique de l'exploitation en imposant, comme externalité, une fluctuation contrôlée des rendements de pêche et de la demande des consommateurs (voir Figure 1).
Figure 1: structure des deux modèles indépendants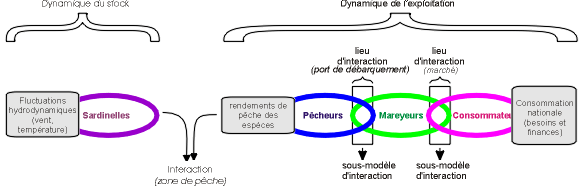 |
La problématique du travail présenté vise à coupler ces deux modèles afin d'étudier les conditions de co-viabilité de l'un et l'autre système. Le premier problème posé consiste à définir les modalités du couplage entre les deux modèles; l'objectif étant de pouvoir étudier particulièrement les interrelations entre les deux entités (ressources - usages). Nous avons donc cherché à définir une interface qui puisse rester la plus simple et la plus contrôlable, tout en restant le plus proche possible de la réalité.
Figure 2: de la perception à la formalisation de la relation ressource -
exploitation.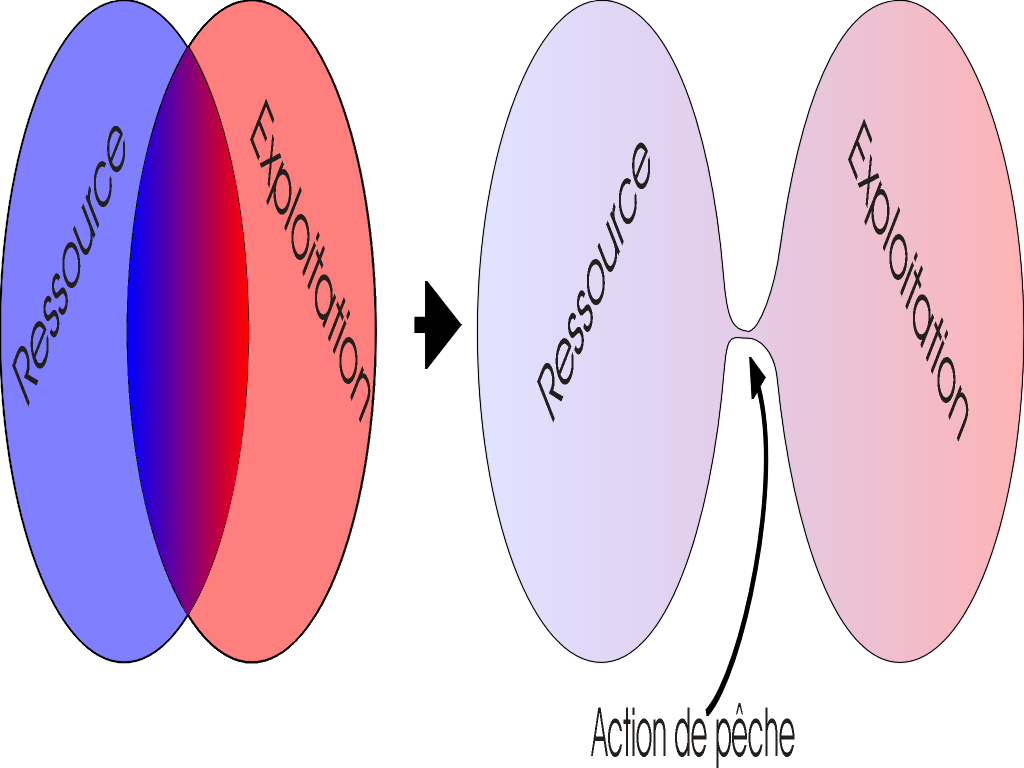 |
|
Figure 3: structure du modèle couplé.
|
Figure 4: Organigramme du processus de couplage entre pêcheurs et poissons (extrait de Le Fur et Bommel, 1999).
Il s'agit de l'organigramme des méthodes impliquées dans l'interaction entre les agents bancs de poissons (cycle de vie modélisé à gauche) et un agent communauté de pêcheur (activité de pêche modélisée à droite).
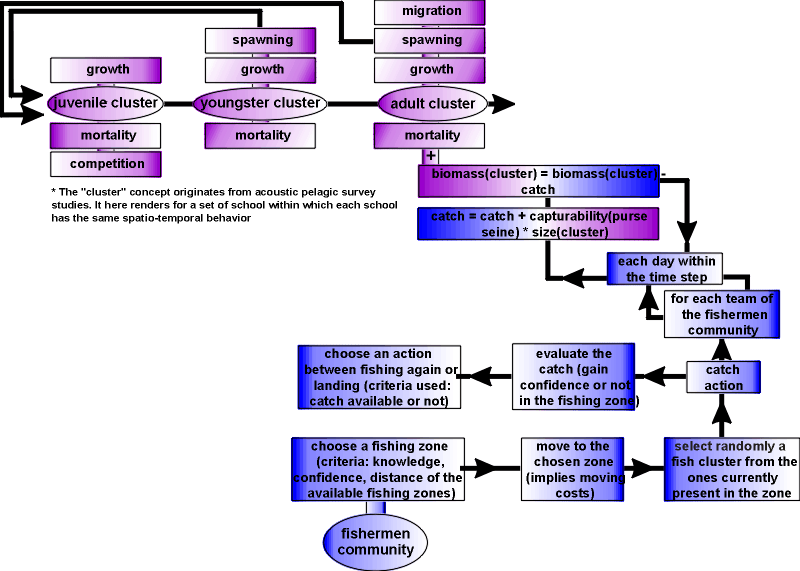
![]()
Deux méthodes sont communes aux deux types d'agents: la première ("catch = …" établit la quantité capturée à partir des caractéristiques
de l'engin utilisé (purse seine = senne tournante), la deuxième ("biomass(cluster) = …" retire cette capture du cluster (ensemble de bancs de poissons) dans lequel l'agent pêcheur
impliqué est en train de pêcher.
Résultats
La parcimonie recherchée pour le couplage permet d'étudier avec précision les effets de tel ou tel changement de l'un ou de l'autre côté de l'interface.
En fonction de la valeur des divers paramètres utilisés dans chaque composant (ressource, pêche, commercialisation, consommation), divers scénarios peuvent être simulés. En fonction des scénarios, les simulations peuvent ou ne peuvent pas conduire à une exploitation viable, c'est à dire qui ne s'éteint pas soit par disparition de la ressource, soit par inefficacité économique.
La figure 5 correspond à une des quelques configurations viables qui a pu être obtenues, la plus proche de ce que l'on connait de l'exploitation sénégalaise (taille et caractéristiques de communautés de pêcheurs, mareyeurs et consommateurs, taille des stocks et captures de sardinelles).
Par simulation, il est possible de modifier et d'étudier tel ou tel aspect vis à vis de la viabilité de l'une ou l'autre composante de la simulation. Ici nous représentons deux effets de la modification du comportement des pêcheurs sur la dynamique du stock.
La figure 6 représente ce que l'on appelle, la transparence de l'écosystème: si les pêcheurs disposent d'une connaissance parfait de la position et de la taille des bancs (connaissance pouvant par exemple être fournie par la recherche sous la forme de cartes de distribution), l'exploitation conduit rapidement à l'extinction du stock.
La figure 7 représente une situation dans laquelle les pêcheurs seraient de parfaits opportunistes (on enlève l'inertie due à leur expérience précédente dans le processus de choix d'une zone de pêche). Là aussi, l'exploitation conduit à la disparition rapide du stock.
Ces deux exemples montrent que, dans ce modèle, l'incertitude et l'inertie des pêcheurs constituent des facteurs de préservation du stock exploité. Les conditions de co-viabilité de l'un et l'autre peuvent donc être cherchées dans des domaines très éloignés de ceux habituellement explorés par l'halieutique biologique ou économique classique.
L'approche globale et trans-sectorielle a été retenue pour représenter, au sein d'un seul modèle, les phénomènes liés aux systèmes écologiques et systèmes économique et l'articulation entre ces deux. Les dynamiques observées indiquent que l'on peut étudier les conditions d'une co-évolution entre dynamiques biologiques, économiques et comportementales. En fonction des scénarios et des environnements simulés on obtient des dynamiques qui peuvent être globalement ou localement viables ou non viables. Les changements sont aussi endogènes, auto-produits par l'organisation et la dynamique interne de l'exploitation (évolutions, seuils et catastrophes, changements de régime, de pentes dans la dynamique de certaines variables).
En ce qui concerne la méthode utilisée, la distinction entre l'échelle utilisée pour la formalisation et l'échelle d'appréhension et d'observation du domaine permet d'aborder la viabilité globale de l'exploitation halieutique sans faire d'hypothèse sur ce niveau de perception. Elle est susceptible de permettre une approche moins biaisée de la dynamique de l'exploitation et de sa ressource vis à vis de l'étude des conditions de sa viabilité, de son aptitude à réagir au changement.